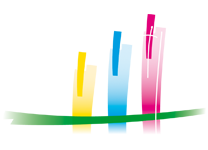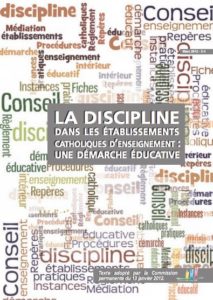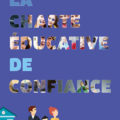Du bon usage du règlement intérieur
Le Comité national de l'enseignement catholique du 30 juin 2017 a adopté la version finalisée d'un texte sur les règlements intérieurs des établissements visant à repréciser les procédures, à les mettre en adéquation avec le droit général comme avec les fondamentaux de l'École catholique. Le tout afin de faciliter l'adhésion des élèves et des familles.
 Les faits attestent, non d’une recrudescence des manquements au règlement intérieur des établissements, mais d’une difficulté croissante à en faire comprendre et appliquer les dispositions et d’une multiplication des situations de crispation avec certaines familles.
Les faits attestent, non d’une recrudescence des manquements au règlement intérieur des établissements, mais d’une difficulté croissante à en faire comprendre et appliquer les dispositions et d’une multiplication des situations de crispation avec certaines familles.
Nombre de situations n’appellent que de simples rappels à l’ordre, d’autres au contraire nécessitent la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. On peut certes le déplorer, mais il est plus indispensable d’adopter les justes attitudes et, sans exagération, de veiller à une certaine rigueur en la matière, et à un respect de plusieurs règles élémentaires, en l’absence desquelles les décisions risquent d’être mal perçues, voire inefficaces.
Ces questions de fond ont déjà fait l’objet d’orientations, telles que le texte sur la discipline voté par la Commission permanente en 2012 (voir ci-contre), les fiches juridiques sur les thématiques de laïcité (ici et là) ou encore la Charte éducative de confiance qui propose des modalités d'organisation la relation famille école.
Dans le prolongement de ces textes, il a semblé utile de proposer un outil, le plus opératoire possible, qui réponde aux situations concrètes, afin de faciliter la tâche des chefs d’établissements, et de préciser les droits et les devoirs de chacun, en matière de discipline, et éventuellement de sanctions.
Avant toute autre chose, il est toujours bienvenu de rappeler quelques repères fondamentaux concernant le règlement intérieur dans un établissement catholique d’enseignement, quel que soit le degré ou le type d’enseignement.
Il s’agit tout spécialement d’articuler le règlement intérieur avec ce qui caractérise toute école catholique : un projet éducatif, autour duquel est rassemblée une communauté éducative, l’un et l’autre placés sous la responsabilité du chef d’établissement (cf. art 115 Statut EC). Le tout irrigué par la pensée sociale de l'Église.
Soit quatre articulations à penser pour le règlement intérieur:
Au projet éducatif
Le règlement intérieur a bien sûr une valeur « réglementaire » comme document écrit régissant les devoirs et droits des acteurs de la communauté éducative. Mais plus encore que cette utilité fonctionnelle, il a aussi et d’abord une valeur éducative. Et c’est cette dimension éducative qui le rattache directement au projet éducatif de l’établissement, qui en constitue le « cadre de référence », cadre qui « oriente et éclaire les décisions à prendre » et qui « précise l’organisation et le fonctionnement de l’école » (art. 124-125 Statut EC).
À la communauté éducative
De la même manière, le règlement intérieur doit essentiellement être rapporté au « vivre ensemble » de la communauté éducative, au sein de laquelle « les rapports interpersonnels que chacun vit, notamment les élèves avec leurs éducateurs, sont éducatifs par eux-mêmes » (art 117 Statut EC).
Ainsi, les dispositions d’un règlement intérieur demeurent-elles ordonnées au fonctionnement d’une communauté qui propose « une éducation aux valeurs et aux attitudes qui doivent leur permettre de régler les conflits de manière pacifique et dans le respect de la dignité́ humaine » et une « formation au sens de l’éthique personnelle et communautaire ». (art. 118-119 Statut EC).
À la responsabilité
du chef d'établissement
Il importe enfin d’articuler le règlement intérieur avec la responsabilité ultime du chef d’établissement. En l’espèce, c’est lui qui « organise la vie de l’établissement et prévoit les structures à mettre en place », lui aussi qui « effectue les arbitrages nécessaires et prend les décisions ultimes qui relèvent de sa fonction » (art 148 Statut EC).
Aux principes de la Doctrine sociale de l'Église
Le rappel de quelques principes de la pensée sociale de l’Eglise peut aussi concourir utilement à une mise en perspective de ces fiches sur le règlement intérieur.
Le service du bien commun suppose de créer sans cesse les conditions favorables au développement de chaque personne humaine. Le chef d’établissement, « garant de l’unité de la communauté éducative » et vigilant « à la cohérence des activités de tous » en porte la responsabilité (art 146 Statut EC).
Ces « conditions favorables » concernent la communauté dans son ensemble, mais aussi chacun des membres singulièrement, y compris le cas échéant les protagonistes d’une situation revêtant un caractère disciplinaire.
Le respect du principe de subsidiarité commande pour sa part que ne soit pas a priori confié à un autre niveau ce que la communauté éducative de l’établissement peut régler par elle-même. Ainsi, à l’exception des cas qui pourraient le nécessiter, le recours à des instances extérieures ne doit pas s’imposer, en particulier dans une excessive forme de judiciarisation.
Enfin, le principe d’« alliance éducative » établit une relation entre les élèves, les parents et les acteurs de la communauté, dans la confiance, qui ne fonctionne donc pas sur le registre consumériste de la prestation de services éducatifs. C’est ainsi que les parents sont invités à « entretenir des relations cordiales et constructives avec les enseignants et les responsables des écoles » (art. 148 Statut EC) : à l’instar de la démarche d’inscription, la relation éducative prend toujours « la forme d’un dialogue entre la famille, le jeune et le chef d’établissement » (art. 65 Statut EC).
Du bon usage de ces fiches sur le règlement intérieur
- Ces documents se présentent comme un conseil apporté aux chefs d’établissements, sous la forme de recommandations, essentiellement pratiques.
- On ne saurait trop insister, en matière de discipline, sur la nécessité constante d’adaptation aux situations particulières de chaque communauté éducative, et de chacune des personnes qui en sont membres. Il conviendra par exemple de tenir compte du degré d’enseignement, ou encore de personnes à besoins éducatifs particuliers, dont la scolarisation s’effectue dans des classes ou dispositifs spécialisés. Une manière de redire que ces fiches sont à recevoir comme un guide, et que les décisions à prendre doivent toujours être référées au projet éducatif spécifique de l’établissement, et toujours être ordonnées à la dignité de la personne humaine.
- La première de toutes les recommandations est évidemment de veiller à une bonne communication: pour être respecté, le règlement intérieur doit être connu. C’est pourquoi il est indispensable qu’il soit présenté aux élèves et aux parents dès la première rencontre avec le chef d’établissement, et qu’ils y souscrivent au moment de l’inscription de l’élève.Cette approche se situera dans le cadre plus large de la construction d’une « alliance » éducative, qui intervient au moment du « dialogue initial » et de l’accueil préalables à l’inscription (art. 64, 65 du Statut de l’Enseignement catholique). Une telle démarche est notamment favorisée par la rédaction d’une « Charte éducative de confiance », dont la signature manifeste la pleine adhésion à la démarche éducative commune.
La mention du respect du règlement intérieur doit également faire partie des obligations des parents figurant dans le contrat de scolarisation, qui précise que la scolarisation de l’élève à laquelle l’établissement s’engage, pourrait être résiliée en cas de sanction disciplinaire ou plus largement en cas de rupture de la confiance éducative, entre la famille et l’établissement. Les motifs disciplinaires de cette rupture doivent être établis objectivement, et ne pas servir de justifications à d’autres raisons, par exemple les résultats scolaires.