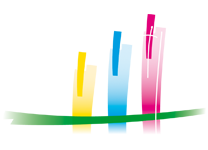Mis à jour le : 30 avril 2024
L’an 2 de la réforme du lycée
Alors que les choix de spécialités effectués l'an dernier par les élèves en sortie de seconde, dessinent le visage du nouveau lycée, la réforme se poursuit. Cette année, les élèves de 1ère inaugurent le contrôle continu introduit dans le nouveau baccalauréat.
 Spécialités : vers des profils de bacheliers plus diversifiés
Spécialités : vers des profils de bacheliers plus diversifiés
Près de la moitié des élèves ont choisi des combinaisons inédites, optant pour des panachages de spécialités que ne permettaient pas l’ancienne organisation : philo et physique, biologie et arts, etc… les profils des lycéens s’annoncent donc réellement moins uniformisés.
Globalement la prééminence des disciplines scientifiques reste toutefois marquée quoiqu’atténuée. Près de deux-tiers des élèves ont en effet plébiscité la spécialité mathématiques mais seuls 26% l’ont assortie avec la physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre, reconstituant la série S, qui était suivie par la moitié des lycéens l’an dernier.
Les résurgences des séries ES (6,8% contre 33% l’an dernier) et L (4,2% contre 15,4%) sont moins prégnantes, les sciences humaines faisant l’objet d’associations moins convenues.
L’enseignement de numérique et sciences informatiques a été choisi par 8 % des élèves, un début prometteur même si ce choix reste quasi-exclusivement masculin, tout comme la spécialité Sciences de l’ingénieur.
Le contrôle continu, mode d’emploi
Trois séries d’épreuves

Au cours de l’année scolaire 2019/2020, les élèves de 1re des voies générale et technologique seront évalués en contrôle continu toute l’année et lors d’épreuves communes de contrôle continu aux 2è et 3è trimestres.
Les élèves de terminale seront concernés également à compter de la rentrée 2020 avec une évaluation en contrôle continu toute l’année et une série d’épreuves communes de contrôle continu.
Les enseignements évalués:
- L’histoire-géographie
- Les langues vivantes A et B
- L’enseignement scientifique pour la voie générale (séries 2 et 3 uniquement) OU les mathématiques pour la voie technologique (séries 1, 2 et 3)
- L’enseignement de spécialité suivi en 1reuniquement (série 2 uniquement)
- L’EPS – contrôle en cours de formation en classe de terminale
Sur les 30% de la note finale que représentent ces évaluations, chaque enseignement compte pour une part égale, équivalente à 5% de la note finale du baccalauréat.
La notation chiffrée dans chaque enseignement est la moyenne des notes obtenues lors des différentes épreuves, quel que soit leur nombre.
La contribution de 10% des bulletins scolaires
Une note de contrôle continu comptant pour 10% de la note finale du baccalauréat est calculée à partir des bulletins scolaires des années de première et de terminale. Ce calcul est automatisé au niveau académique et n’est pas effectué dans les établissements. La note correspondante résulte des principes suivants :
- Elle est calculée en deux parties : l’année de premièreavec un coefficient 5, puis l’année de terminale avec un coefficient 5.
- Ces deux moyennes annuelles sont validées au moment du dernier conseil de classede l’année concernée, dans le livret scolaire.
- Tous les enseignements comptent à égalité, qu’ils soient obligatoires ou optionnels.
- C’est la moyenne annuelle figurant dans le livret scolairedu lycée qui est prise en compte, quels que soient le nombre et la nature des évaluations.
- Les notes obtenues dans les épreuves communes de contrôle continu ne sont pas comptabilisées dans le calcul des moyennes de livret.
Les outils du Ministère
- Les infographies récapitulant les coefficients et calendriers
Le contrôle continu en voie générale
Le contrôle continu en voie technologique
- Un diaporama sur les modalités d’organisation du contrôle continu (calcul de la note, parcours particuliers…) récapitulant les directives de l’arrêté du 16 juillet 2018 et une note de service de la Dgesco publiée au BO le 25 juillet 2019.
Les programmes
Les derniers programmes ont été publiés le 25 juillet 2019, en complément des programmes déjà communiqués en janvier 2019.
Les modalités d’organisation incombent aux établissements
Chaque établissement scolaire envoie une convocation nominative à chaque candidat. En cas d’absence pour cause de force majeure, le candidat est convoqué à une épreuve de remplacement. En cas d’absence non justifiée, le candidat est noté zéro à l’épreuve.
Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont tirés d’une banque nationale de sujets. Une note de service spécifique sera consacrée à ce dispositif. Les sujets sont sélectionnés sous l’autorité du chef d’établissement.
Les copies sont anonymes et corrigées par d’autres professeurs que ceux des élèves.
Dans chaque académie est constituée une commission d’harmonisation, présidée par le recteur et composée d’IA-IPR et de professeurs nommés par le recteur pour chaque session du baccalauréat. Cette commission intervient notamment en cas d’écart conséquent avec la moyenne académique sur un lot de copie ou sur un sujet.
Après validation des notes par le jury final, les copies sont remises aux candidats. Chaque établissement doit conserver une reproduction des copies corrigées (papier ou numérique) pendant encore un an après la publication des résultats de la session concernée.