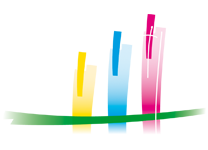Publié le : 13 février 2025
20 ans d’éducation inclusive : retour sur notre table ronde
Le 11 février 2005, la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » voyait le jour. Cette avancée majeure a marqué un tournant historique dont se sont emparés les établissements de l’Enseignement catholique pour repenser et enrichir leurs pratiques éducatives, au service de l’accueil de la différence et de la reconnaissance du droit à l’école pour tous. Quel bilan 20 ans plus tard ? Nous en parlions le mardi 11 février, à l'occasion d'une table ronde réunissant plusieurs grands acteurs de l'inclusion.

Adoptée après d’intenses débats parlementaires, la loi de 2005 repose sur un objectif : favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour la communauté éducative, elle a conduit à une refonte des pratiques, permettant aux établissements scolaires de développer de nouvelles pédagogies et moyens pour accueillir tous les élèves. Cependant, comme le rappelle Marie-Anne Montchamp, ancienne secrétaire d’État aux personnes handicapées, la mise en œuvre de cette loi a nécessité des ajustements constants : "l'esprit de la loi de 2005, c'est celui de la citoyenneté. Il faut en cultiver le sens à défaut d’en cultiver la lettre, car les textes méritent toujours d'évoluer." Le défi était de stabiliser un texte riche en contributions diverses et de l’adapter aux réalités du terrain, "pour arriver au fond, à un commun à partager et donner naissance à une politique qui ne laisse plus sur le bord de la route, aucun enfant en situation de handicap".
Animée par Marc Tronchot, ancien directeur de la rédaction d'Europe 1
- Marie-Anne Montchamp : Directrice générale de l'OCIRP, ancienne secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées au moment de l'adoption de la loi
- Charles Rozoy : Vice-président chez SAUR, ancien conseiller éducation et emploi de la Ministre chargée des personnes handicapées et champion paralympique 2012
- Philippe Castille : Directeur diocésain de Chartres
- Laura Mekaelian : Enseignante de SVT, coordinatrice PIAL à Marseille
- Véronique Poutoux : Formatrice et auteure
- Nathalie Tretiakow : Adjointe au Secrétaire général de l'enseignement catholique
L’éducation, un terrain d’expérimentation et de tensions
Dans les écoles, cette loi a entraîné une prise de conscience progressive des enjeux liés à l’inclusion. Philippe Castille, directeur diocésain en Eure-et-Loir, évoque l’évolution des pratiques au sein de l’Enseignement catholique: d’abord axées sur l’intégration d’élèves en difficulté avec une "certaine prise de conscience de la part des enseignants pour s'adapter, compenser" puis sur une réelle inclusion avec la mise en place de dispositifs spécifiques comme les ULIS. Aujourd'hui, pour le directeur diocésain, l'enjeu est "de créer des unités de lieu et de trouver des synergies entre les professions de l'éducations nationales et le médico-social."
Malgré ces avancées, de nombreuses difficultés persistent. Le manque de formation des enseignants est régulièrement pointé du doigt, tout comme la lenteur administrative des décisions d’accompagnement. Pour Charles Rozoy, champion paralympique, ancien conseiller éducation et emploi de la Ministre chargée des personnes handicapées, le principal frein reste la perception de la différence : "Cette loi incarne une volonté de changement avec un axe fort : le respect des droits et des personnes en situation de handicap. Plein de choses doivent encore évoluer mais une loi ne peut pas changer le problème de fond d'une société qui n'accepte pas la différence." Même son de cloche pour Véronique Poutoux qui interroge "On veut une école inclusive mais notre société l’est-elle ? Entre une école élitiste et une école pour tous on veut quoi ? L'enjeu : accompagner les enseignants pour qu'ils puissent anticiper les obstacles à l'apprentissage."
Un cadre à repenser pour une inclusion réelle
La loi de 2005 a posé des bases solides, mais elle se heurte aujourd’hui à un cadre normatif rigide comme le souligne Marie-Anne Montchamp : "Le référentiel pour l'école qui s'impose à nous laisse beaucoup d'enfants sur le bord de la route. Il ne faut pas avoir peur de proposer des modèles alternatifs, d'écoles refondées. Un projet politique doit interroger ces référentiels, pour déplacer les curseurs." Une idée partagée par Nathalie Tretiakow, adjointe au Secrétaire général de l'Enseignement catholique, pour qui l’école française est historiquement conçue comme un système de sélection, ce qui complique l’intégration des élèves les plus fragiles. Selon elle, il ne suffit pas d’ajouter des dispositifs, il faut repenser en profondeur la structure même de l’école pour qu’elle devienne réellement inclusive.
De son côté, Laura Mekaelian, enseignante en zone prioritaire, insiste sur l’importance du lien humain. Pour elle, l’inclusion ne repose pas uniquement sur des textes, mais aussi sur l’engagement des équipes pédagogiques à accompagner chaque élève selon ses besoins spécifiques. C’est dans ces moments d’échange et de compréhension que la véritable magie de l’inclusion opère.
L'apport de la loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » - explications 👇
« Le soin envers les plus fragiles : un hymne à la dignité humaine » : le regard de Philippe Delorme, Secrétaire général de l'Enseignement catholique👇

Et après ?
Vingt ans après son adoption, si la loi de 2005 montre certaines limites elle reste néanmoins un socle essentiel pour l’avenir de l’inclusion en France. Si la volonté politique et les avancées législatives sont là, leur application reste inégale et perfectible. L’enjeu des prochaines années sera donc de simplifier les démarches, de renforcer la formation des enseignants et de poursuivre la transformation des mentalités. "Prenons le temps de révéler les pépites d'innovations qui vivent dans nos établissements. Le mouvement part du local pour chercher et construire des réponses mais il faut que le national et le politique aident ce mouvement là par un accompagnement adapté" conclut Nathalie Tretiakow.