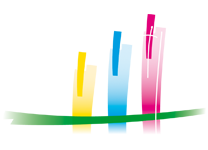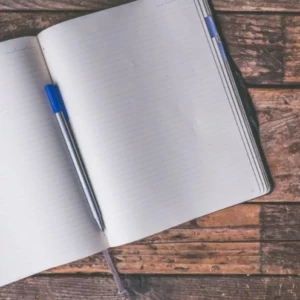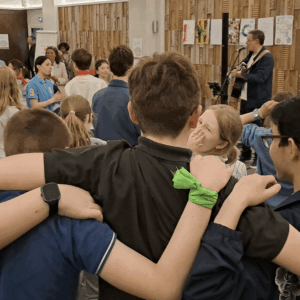Publié le : 1 avril 2025
« L’inclusion est un processus d’interactions »
Fervent défenseur de l’école inclusive, David Rodrigues, ancien professeur d’éducation spécialisée, est aujourd’hui conseiller national d’éducation au Portugal. Le 15 janvier 2025, lors d’une conférence organisée à Rennes, en lien avec la direction diocésaine d’Ille-et-Vilaine, très engagée dans la dynamique d’inclusivité, il rappelait cette idée : une inclusion réelle requiert un environnement commun et la collaboration entre l’ensemble des acteurs.

Sur quoi se fonde votre engagement pour une école plus inclusive ?
David Rodrigues : Mon engagement se fonde sur deux idées. Tout d’abord celle que l’éducation est avant tout un droit fondamental, reconnu par le droit international et garanti par les notions d’inclusion et d’équité. On ne peut pas disposer du droit à l’éducation de certains. Ainsi, on ne peut pas dire à un élève : « Toi, oui, tu es bon pour apprendre » et puis à un autre, « Toi, non, tu dois quitter l’école et travailler ». Tous les élèves ont la même importance et tous sont capables d’apprendre. L’apprentissage est une caractéristique intrinsèquement humaine.
Pour vous, il n’est pas de droit à l’éducation sans école inclusive ?
David Rodrigues : L’inclusion est garante de nombreux autres droits, c’est le concept de droit multiplicateur. Elle a cette double nature d’être un objectif mais aussi un moyen, un outil pour atteindre son propre objectif, à savoir l’éducation pour toutes et tous.
Quelle est votre définition de l’école inclusive ?
David Rodrigues : Déjà, l’inclusion c’est pour tous et ensemble. De façon scolaire, l’école inclusive peut se définir selon cinq aspects conceptuels. Il y a le concept de droit multiplicateur que je viens de citer. On peut aussi nommer le concept d’inclusivité comme caractéristique des systèmes éducatifs visant à garantir une éducation de qualité pour tous, dans des environnements communs. Ensuite, vient le concept de suppression des barrières auxquelles chaque individu est confronté pour apprendre. Puisque tous les élèves sont capables d’apprendre, c’est à nous professionnels d’identifier les obstacles à l’apprentissage, au sein de l’École. Puis viennent les concepts d’environnements habilitants : l’inclusion ne peut être comprise si nous pensons en termes de personnes isolées identifiées par leurs problèmes. Ce serait comme essayer de comprendre une ruche en étudiant une seule abeille. L’inclusion est un processus d’interactions, de relations, de dimension sociale et sociologique (avec des implications extérieures). Le dernier concept est celui de l’inclusion comme réforme éducative et non comme quelque chose qui s’ajoute ou se colle à l’École. Parfois, quand j’arrive dans un établissement en France, j’entends « Ah l’inclusion c’est avec Nathalie… ». Le problème c’est que quand Nathalie a la grippe, l’inclusion est aussi absente… Parfois c’est juste une salle : on me dit « l’inclusion c’est en salle 10 ». Il faut comprendre que l’inclusion ne se résume pas à une personne, à un lieu…ce doit être une valeur transversale de l’École, sinon, cela ne fonctionne pas.
Comment se met en œuvre le concept d’école inclusive au Portugal ?
David Rodrigues : Au Portugal, au sortir de la dictature, il y avait de gros besoins au niveau éducatif, le taux d’analphabétisme atteignant les 32 %. C’est tout le système éducatif qui a été réformé depuis, par le prisme de l’inclusion. Aujourd’hui 99 % des enfants handicapés sont scolarisés en école ordinaire, nous disposons de 90 centres de ressources pour l’inclusion, et au global, l’éducation au Portugal se porte bien : 52% des jeunes de 18 ans accèdent à l’enseignement supérieur et le taux de décrochage scolaire est inférieur à 6 %.
Comment intégrer ce concept dans les législations nationales ?
David Rodrigues : 68 % des pays ont aujourd’hui intégré l’éducation inclusive dans leurs lois, leurs politiques ou planifications. Cela change doucement. Il y a cinq leviers sur lesquels s’appuyer pour rendre l’École plus inclusive. Le premier serait de prendre en compte le programme scolaire comme un outil d’orientation et non comme un déterminisme. Quand on prépare le programme, on doit se demander qui va en être exclu et chercher à aller vers une conception universelle de l’apprentissage. Le second est l’innovation inclusive, notamment à travers l’apprentissage actif ou le design thinking. Ensuite, il convient de penser la mise en lien des ressources extérieures à l’École, comment doivent-elles s’articuler avec l’établissement ? Car l’école inclusive ne peut se penser de façon individuelle, la collaboration entre différents acteurs est essentielle. Et enfin, les politiques publiques doivent être orientées en faveur de l’inclusion. Au Portugal, l’École à temps plein a été déterminante. Les enseignants ne travaillent que dans une seule école, avec du temps pour le soutien, etc.
Quels sont les obstacles à l’éducation inclusive ?
David Rodrigues : Quand on parle de handicap, c'est toujours en théorie et à la troisième personne. Pourquoi n’entend-t-on pas davantage de personnes concernées s’exprimer sur le sujet à la première personne ? Ce n’est pas un objet de glose, abstrait, c’est concret, humain. Les Jeux paralympiques, c’est bien, mais ponctuel. Ce qu’il faudrait, ce sont des journalistes en situation de handicap ou des responsables de l’Éducation nationale en situation de handicap… Aujourd’hui, lorsque c’est le cas, le handicap est souvent postérieur à la prise de poste. L’inclusion ne devrait pas être perçue comme une contrainte mais comme une source de diversité et de richesses. Des gens vont à l’autre bout du monde parce que la nouveauté apporte une sensation de bonheur. Découvrir de nouveaux fonctionnements humains est encore plus puissant. C’est inépuisable ! Travailler dans l’univers du handicap rend bien plus riche que de travailler dans la haute finance !
Le succès de la semaine de l’autisme, le 2 avril, est-elle une source d’espoir ?
David Rodrigues : Aujourd’hui, il y a encore cette idée qu’il est plus facile pour un professeur d’enseigner dans un milieu une classe homogène, alors que l’inverse est observé : un enfant handicapé inclus en classe ordinaire développe plus de compétences qu’en milieu protégé. Il faut en finir avec cette culture du « deux types de personnes » : les normaux et les spéciaux. Un enfant trisomique apprend à lire comme tous les autres enfants, les étapes d’apprentissage sont les mêmes, la seule chose qui diffère c’est la durée de l’apprentissage. En arrêtant de caractériser une personne par son handicap, on se rendra compte qu’il n’y a pas beaucoup de différence d’intervention entre un enfant ordinaire et un enfant en situation de handicap. Le concept d’école inclusive vient à contre-courant de l’école traditionnelle, si l’on veut vraiment combattre l’inégalité et l’exclusion, on doit être convaincu que l’école inclusive est la solution, sans cette conviction, cela ne changera pas. Nous avons besoin de réimaginer ensemble nos futurs.

David Rodrigues
Conseiller national d'éducation au Portugal
Dans un rapport intitulé Éducation inclusive et formation continue des professeurs, basé sur des interview et des focus groupes permettant d’analyser les formations continues des professeurs au sein de différents pays (Argentine, Brésil, Uruguay, Portugal, Espagne, Écosse…), David Rodrigues propose plusieurs pistes d’action : l’obligation de formation continue dans la carrière d’enseignant, la mise à disposition de structures de formation adaptées avec une analyse des besoins prioritaires, des profils de formateurs experts… Pour le spécialiste, il est primordial de mettre en place un lien de confiance entre le ministère de l’Éducation nationale et la communauté enseignante et de démocratiser l’idée d’un apprentissage continu, obligatoire, auxquels les professeurs auraient accès durant toute leur carrière.