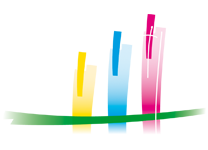
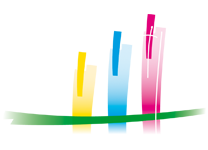
Quelles sont les spécificités de l’enseignement catholique ? La réponse est ici en quatre entrées.
La première présente le projet éducatif, qui, bien que commun à tout le réseau, se décline en autant de colorations particulières qu’il y a d’établissements.
La deuxième explique en quoi l’enseignement catholique participe loyalement à la mission de service public d’éducation tout en disposant de marges de liberté définies par son association par contrat à l’État.
Les deux dernières témoignent de son enracinement dans l’Église et des conceptions éducatives qui en découlent.
Pierre angulaire de chaque établissement, le projet éducatif exprime à la fois la source et la visée de l'engagement de ses enseignants, ses personnels et des familles. il joue un rôle majeur dans la rencontre avec ces dernières, lors de l'entretien d'inscription. Il garantit la cohérence et la cohésion de la communauté éducative.
Les déclinaisons singulières d'une visée commune
L’autonomie de chacune des écoles catholiques s’exprime par son projet éducatif. « La finalité d’une école catholique se traduit par son projet éducatif. Chaque école catholique présente donc un visage singulier. » (article 19 du statut de l’Enseignement catholique). Le projet éducatif aujourd’hui écrit, pour la plupart des écoles, formalise en l’actualisant l’intuition fondatrice qui a conduit à la création de l’établissement. Les divers projets des nombreux établissements se fondent tous sur la vision chrétienne de la personne humaine pour redire à la fois la source et la visée de l’action éducative entreprise.

Mais chacun des projets, à partir de cette référence commune, choisit de mettre les accents particuliers liés à l’histoire de l’établissement, à l’environnement social et ecclésial dans lequel il se situe, aux urgences éducatives auxquelles il a à répondre « ici et maintenant ». Les projets éducatifs des établissements congréganistes sont bien entendu marqués par l’inspiration particulière des fondateurs.
Le projet éducatif, qui précise quel type d’homme et de femme l’établissement envisage de former, développe alors les orientations nécessaires pour ce faire, dans le champ de la transmission des savoirs et de l’éducation de la personne dans toutes ses dimensions. Il donne les repères nécessaires pour penser la relation éducative et pédagogique, l’animation de la communauté éducative et l’organisation de l’établissement. Le projet éducatif fixe donc une visée à la tâche quotidienne de chacun des acteurs et permet de discerner les modalités concrètes de l’action éducative de l’établissement.
Au service du choix éclairé des familles
Le projet éducatif doit être utilisé lors des entretiens d’inscriptions car la coloration qu'il confère aux établissement permet d'éclairer la décision des familles. En effet, le recrutement des établissements catholique se fonde sur la liberté de choix, reconnue aux familles. Il ne peut donc pas dépendre, comme pour les établissements publics, de la carte scolaire et d’une logique d’affectation. L’inscription procède d’une rencontre entre la famille et souvent l’élève lui-même et l’établissement, généralement représenté par le chef d’établissement en personne. Lors de l’entretien, les premiers exposent leur projet parental d’éducation, et pour les élèves suffisamment âgés pour l’exprimer, leur projet personnel de formation. Le second présente le projet éducatif. L’échange permet alors de vérifier que les attentes des uns peuvent bien s’inscrire dans les propositions faites par l’école choisie.
Le projet sert aussi à mobiliser l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. « Tous les membres de la communauté éducative connaissent les fondements et reconnaissent les visées de l’engagement éducatif de l’école catholique. Ils sont conjointement et librement associés au même projet éducatif » (article 34, statut de l’Enseignement catholique).
Un gage de cohérence et de cohésion
Personne ne vient par contrainte dans un établissement catholique. Les parents et les élèves, nous venons de le rappeler, s’inscrivent dans un établissement choisi. Les enseignants décident librement d’exercer leur métier dans une école catholique associée à l’État par contrat. Ils posent un acte de candidature. Les personnels de droit privés sont recrutés suite à un entretien d’embauche et tous les bénévoles qui rendent service aux divers établissements le font au nom d’un engagement personnel. Il appartient dès lors aux responsables institutionnels et notamment aux chefs d’établissement, de présenter à chacun le projet de l’établissement choisi pour s’y engager à un titre ou à un autre. Le projet n’est pas alors un texte descriptif mais le cadre utile pour que chacun puisse inscrire sa liberté d’action et la mobilisation de ses compétences, au service du bien commun. En effet, le projet n’a d’existence que s’il est porté par la communauté éducative. C’est bien d’ailleurs la communauté qui élabore le projet, sous l’impulsion du chef d’établissement et avec l’accompagnement de l’autorité de tutelle. Ainsi, la communauté « fait » projet mais, tout autant, le projet « fait » communauté, donnant cohérence à son action et cohésion à son organisation.
Les établissements catholiques se réfèrent à l’Évangile tout en étant associés à l’État par contrat. Au nom de cette spécifié, ils accueillent tous ceux qui le souhaitent, dans le respect absolu de la liberté de conscience de chacun, tout en proposant, sans imposer, un message chrétien et une annonce explicite de la foi.
L’association à l’État pour la plupart des établissements privés traduit la volonté de participer au système public d’éducation. Alors que les courants libéraux souhaiteraient privatiser une partie significative de l’offre de formation, que s'ouvrent de plus en plus d’instituts lucratifs vantant leurs performances, que les parents pourraient souhaiter acheter des produits de formation comme tout autre marchandise, l’association à l’État par contrat dit la volonté de s’inscrire dans la recherche du bien commun et de refuser de se situer comme un prestataire répondant à des demandes consuméristes. L’école doit rester ce creuset du vivre ensemble, de la construction d’une culture commune, permettant de faire société.

Associé mais autonome
Simultanément, l’association à l’État par contrat dit une conception de la recherche d’unité qui ne soit pas uniformisante, une conception de contribution au service public qui conjure les risques du monopole d’État. Il s’agit aussi de travailler à une utile complémentarité, à une saine émulation pour éviter une concurrence stérile. Des parents, des associations craignent que le contrôle de l’État n’empêche une réelle liberté pédagogique. L’Enseignement catholique a rappelé, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la loi Debré, les garanties apportées par le contrat en matière de liberté : « Il est clair que le contrôle pesant sur les établissements d’enseignements privés est un contrôle limité aux cas et modalités prévues par les textes régissant les relations entre l’État et l’établissement pour l’exécution de sa mission de service public. Tout ce qui ne relève pas du contrôle de l’État relève de la libre appréciation de l’établissement et des organes qui le représentent. C’est à partir de ce raisonnement que l’on peut déduire l’autonomie dont disposent les établissements associés dans l’exercice de leur mission de service public et qui permettent de mettre en œuvre leur caractère propre. »
La culture de l’association n’est donc pas une soumission, inféodation
mais requiert au contraire l’exploration de toutes les espaces de liberté qui laisse la loi.
D’autres parents, d’autres associations craignent que l’association à l’Etat n’empêche l’affirmation de l’identité catholique des établissements. Nous avons rappelé l’impératif de l’ouverture à tous, qui fait, bien entendu, qu’une école catholique n’est plus confessionnelle si l’on désigne par ce terme une école dont la totalité de l’encadrement et de l’animation est assurée par des catholiques pratiquants, s’adressant à des élèves tous baptisés et catholiques pratiquants. Mais cette ouverture à tous affirmée par l’école catholique comme un « choix pastoral » ne doit pas contraindre l’expression de la tradition éducative propre à l’Église, traduite dans le projet de chacun des établissements. Selon l’expression souvent employée par Paul Malartre, ancien secrétaire général de l’Enseignement catholique « une école catholique n’est pas une catholique par son recrutement mais par son projet. »
Ainsi, le projet des établissements catholiques se réfère à l’Évangile et à l’Enseignement de l’Église mais il est aussi un établissement d’enseignement associés à l’État par contrat en vertu de la loi de 1959.
Liberté de l’Institution et liberté de la personne
Le contrat lie les établissements catholiques d’enseignement à l’État laïc. Le contrat doit permettre aux deux partenaires d’exprimer ce qui les fonde. L’État doit faire valoir la laïcité qui exige la liberté de conscience et le libre accès de tous aux établissements associés par contrat ; l’Église doit faire reconnaître les établissements catholiques d’enseignement comme un espace où la foi chrétienne peut s’exprimer publiquement. L’article 1 de la loi Debré qui concerne bien entendu les établissements privés dans leur ensemble, et non les seuls établissements catholiques, précise ces obligations réciproques : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances y ont accès. » Il appartient bien entendu à chaque établissement privé de définir son « caractère propre ».
Liberté d’exposer les valeurs chrétiennes
L’Église de France et les responsables de l’enseignement catholique français s’expriment régulièrement pour définir le caractère propre des établissements catholiques d’enseignement. En 1969, les évêques de France présentent l’originalité de l’école catholique comme le fait de « lier dans le même temps et dans le même acte l’acquisition du savoir, la formation de la liberté et l’éducation de la foi : elle propose la découverte du monde et le sens de l’existence » (Art 65). Ouvrant la démarche d’assises en 2001, Paul Malartre emploie à nouveau la même expression « lier » : « En fidélité à ses sources et à ce qui a marqué son histoire, [l’enseignement catholique] se veut […] utile en liant dans une même démarche l’enseignement, l’éducation de toute la personne et la proposition d’un sens de la vie et de la foi. » (Art. 66) Dès lors, l’établissement catholique associé par contrat apparaît comme un espace où peuvent s’articuler le respect absolu de la liberté de conscience de la personne et la liberté de l’Institution de déployer son projet, dès l’instant où le projet se fait invitation et s’interdit toute forme de contrainte : « L’école catholique ne peut pas renoncer à la liberté de proposer le message et d’exposer les valeurs de l’éducation chrétienne. […] Il devrait être clair à tous qu’exposer et proposer n’équivaut pas à imposer. »
Responsabilité éducative du christianisme
Certains s’interrogent néanmoins sur l’exact projet de l’enseignement catholique. Le maintien de cette institution ne serait-il pas une tentative de « reconquérir du terrain » lorsque l’Église institutionnelle s’affaiblit, et que certains repères catholiques s’effacent ? Ne serait-ce pas alors, finalement, une menace, encore, pour la liberté de conscience ? Nous pensons au contraire que partager les valeurs chrétiennes peut contribuer à fonder la liberté de chacun. Bien des philosophes et des sociologues soulignent la fragilisation des démocraties contemporaines, en Europe, liée à l’éclatement des repères communs. « L’État laïc lui-même ne dispose pas du droit de dicter un fondement commun ultime aux valeurs communes. C’est leur faiblesse et leur grandeur. Faibles, elles le sont puisque le pouvoir politique ne peut plus imposer l’adhésion aux valeurs au nom du sacré et du divin. Grandes, elles le sont parce qu’elles dépendent de la libre reconnaissance, quant à leur ultime légitimité. » Dès lors, la société laïque et démocratique peut attendre des convictions spirituelles, religieuses et philosophiques une aide pour fonder les valeurs communes nécessaires. « Elles doivent offrir aux citoyens qui le veulent l’occasion de vivre-ensemble. Aucune religion ne peut s’approprier ces valeurs. Mais la pensée démocratique peut attendre des grandes options spirituelles et philosophiques que, détenant la capacité de fonder ultimement les principes, elles s’emploient à aider l’éducation de citoyens profondément assurés de la légitimité des principes et des valeurs de notre vivre-ensemble. » Pour s’inscrire dans la société laïque contemporaine, l’Église est alors appelée à ce que Marcel Gauchet nomme le « civisme chrétien », c’est-à-dire à « proposer une version de l’ensemble social conforme aux valeurs religieuses mais qui soit respectueuse, simultanément, du caractère non religieux de cet ensemble ». Le christianisme n’en a donc pas fini de sa responsabilité éducative. Les évêques en appellent à un engagement qui soit à la fois spirituel et social : « Il ouvre l’esprit à des savoirs nouveaux, il permet de s’approprier un héritage, il contribue à la construction des personnes, et, en même temps, il donne à des jeunes de se situer dans le monde et dans la société en y prenant leur place à partir de choix réfléchis avec d’autres. »
Bien entendu ce travail ne requiert pas d’adhérer à la foi catholique : « Cette inscription qui offre à l’humanité la fécondité de la Source, contribue à l’accomplissement de l’humanité, au service de tous, mais il n’a pas pour objet de rendre “chrétien” tel ou tel. » Cet appel doit bien entendu rejoindre tous les chrétiens pour s’inscrire dans la société, et tous les enseignants, qu’ils exercent dans l’enseignement public ou dans l’enseignement catholique. Mais la place de l’enseignement catholique reste, à cet égard, spécifique, car elle offre un cadre institutionnel à la formation d’un « civisme chrétien » : « La spiritualité chrétienne est liée à des institutions. Elle n’est pas un parfum qui flotterait dans l’air. Elle s’inscrit dans une histoire, elle fait partie d’une tradition et elle a sa place à l’intérieur de ce travail d’éducation qui est le terrain spécifique de l’enseignement catholique. »
Liberté de proposer la foi
Il est un domaine où la question de la liberté se pose pour notre société, et tout particulièrement dans l’enseignement catholique, c’est la proposition de la foi. Faut-il prendre la parole ou plutôt se taire, avec l’intention de laisser chacun libre de ses choix ? C’est assurément là une illusion du monde contemporain de penser qu’un choix peut s’exercer s’il n’est pas éclairé par une connaissance préalable, et s’il n’est pas structuré dans le cadre d’une réponse à une invitation. Une liberté, sans être contrainte, a besoin d’être éclairée. « La liberté religieuse, l’une des libertés fondamentales, réaffirmée par le Concile Vatican II, ne se traduit pas dans le silence et le mutisme. Elle s’exerce en réponse à une parole adressée, à une invitation reçue. […] loin de contraindre, l’annonce de l’Évangile suscite les libertés. »
La foi chrétienne s’est longtemps transmise comme un héritage collectivement assumé dans beaucoup de familles et dans la société au sein de laquelle l’Église était fortement présente. Ces médiations traditionnelles d’un environnement porteur se sont progressivement affaiblies. Dès lors, le choix de croire est un engagement personnel qui requiert un véritable « acte de foi ». C’est ce dont témoignent fortement les catéchumènes. Mais pour que cet acte de foi libre soit possible, la responsabilité des chrétiens est grande, appelés qu’ils sont à témoigner de leur foi. C’est la dynamique de la pastorale de la proposition : « Nous avons à accueillir le don de Dieu dans des conditions nouvelles et à retrouver en même temps le geste initial de l’évangélisation : celui de la proposition simple et résolue de l’Évangile du Christ. » La même Lettre aux catholiques de France précise plus loin : « Si, de tout temps, l’annonce de l’Évangile fut exigeante, c’est qu’elle doit se faire témoignage. Témoignage de la source vive qui a changé notre vie et que nous osons proposer à la liberté d’autrui, mais aussi témoignage en actes qu’une vie est réellement transformée lorsqu’elle propose une telle foi. Les premières communautés chrétiennes ne se sont pas contentées d’annoncer le Christ ressuscité, elles ont attesté aussi la puissance transformatrice de la foi et l’ont incarnée dans un agir dont la référence était la pratique de Jésus. »
Une proposition explicite de la foi, respectueuse de la diversité des cheminements
Il est donc une parole nécessaire aujourd’hui qui, sans risquer le prosélytisme indiscret, permet aux chrétiens de rendre compte de leur espérance et d’inviter. Cet appel s’adresse à tous les éducateurs chrétiens, quel que soit leur lieu d’exercice, mais interroge plus fortement l’enseignement catholique : « Je plaide, avec d’autres, pour que l’engagement éducatif des catholiques soit revalorisé pour lui-même et qu’il apparaisse comme un domaine privilégié de l’évangélisation. Car il s’agit de donner à des enfants et à des jeunes, et aussi à des adultes, des raisons de croire, en montrant de façon méthodique, que la foi chrétienne n’est pas un cri, ni un sentiment enfermé dans le secret du cœur, mais qu’elle porte en elle une capacité de comprendre le monde, les autres et soi-même, dans la lumière de Dieu. »
Cette attention à la proposition de la foi reste essentielle pour le déploiement du caractère propre, si l’on y travaille avec la « douceur » à laquelle l’Évangile nous appelle. Il est fondamental d’être particulièrement attentif à la diversité des cheminements des enfants, des jeunes et des adultes accueillis dans une école ouverte à tous. « L’évangélisation et la catéchèse devront donc s’accompagner d’une grande attention à l’humain, à ses potentialités et à ses faiblesses, à ses blessures, à ses joies. Et elles devront savoir ne jamais juger, mais corriger et orienter avec fermeté et douceur. Cela est essentiel en particulier devant des jeunes qui doivent trouver le temps et la manière de se dire, de dire leurs problématiques humaines, pour pouvoir accéder à une adhésion à la parole et à la personne de Jésus. La parole de Dieu, dont l’humanité de Jésus de Nazareth a fait le récit, exige de ceux qui l’annoncent qu’ils sachent la vivre et la transmettre comme une réalité humanisante, capable d’ouvrir un horizon et de créer sens dans des situations humaines concrètes. »
L’école associée à l’État par contrat permet la reconnaissance de la liberté d’enseignement. Les parents sont ainsi libres de choisir l’école de leurs enfants ; les enseignants sont ainsi libres de choisir le réseau d’établissements dans lequel ils veulent enseigner ; les établissements sont ainsi libres de déployer leur caractère propre. Les établissements catholiques d’enseignement doivent être à l’aise pour vivre la liberté et pour éduquer à la liberté puisqu’ils fondent leur projet sur l’Évangile qui, sans cesse, suscite les libertés.
L'anthropologie chrétienne nourrit l'École catholique. C'est pourquoi elle promeut l'égale dignité des hommes, éduque à la liberté dans sa nécessaire articulation à la responsabilité et vise à former de jeunes adultes unifiés et ouverts au dialogue.
Dès son premier article, le Statut fonde l’éducation sur la dignité de la personne humaine et l’article 6 rappelle que l’école est un lieu privilégié d’éducation au service de la formation intégrale de la personne. Chacune des écoles catholiques est constituée d’une communauté éducative qui est une communauté de personnes. Cette préoccupation centrale explique aussi la place donnée à l’engagement des personnes, à leur formation, et à l’attention qui doit être portée à chacun dans l’animation des écoles catholiques et de toutes les instances.
art. 10 Au service de l’homme et de son éducation, l’Église manifeste qu’elle porte sur toute personne un regard d’espérance.

Ce regard d’espérance est celui que le Christ porte sur la personne humaine :
art. 74 La mission éducative se fonde sur la pédagogie du Christ. Elle déploie solidairement une attention : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? », un appel toujours personnel : « Viens... », une confiance en chacun : « Va...», une promesse d’accompagnement : « Je serai avec vous... » [Mc 10,51 ; Lc 18,22 ; Jn 20,17 ; Mt 28,20].
Ainsi, la pédagogie du Christ se déploie-t-elle toujours en trois temps : l’appel, l’accompagnement et l’envoi.
L’égale dignité de toute personne humaine
Toutes les personnes humaines jouissent d’une égale dignité. Mais l’égalité est reconnue entre des personnes, dont doit être aussi respectée la singularité. Un projet d’éducation doit précisément veiller à éveiller et accompagner la vocation personnelle de chacun (art. 37, 79).
art. 2 L’éducation se conforme à la vocation personnelle et sociale des hommes en leur permettant de grandir dans l’amour et la vérité et, ainsi, d’accéder à « une vie pleine et libre, une vie digne de l’homme » [Vatican II, Gaudium et Spes, n° 9].
Toute communauté humaine est donc composée de personnes caractérisées par des différences. Faire communauté n’est possible qu’en conjurant la tentation de l’égalitarisme et le refus de la différenciation. C’est le risque de Babel :
« [...] Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue [...] ». (Genèse 11,6) Le récit de la Pentecôte, au contraire, souligne que l’unité est possible dans la diversité. Tous les peuples rassemblés écoutent un même message, mais chacun dans sa langue maternelle.
« Nous les [les apôtres, galiléens] entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu ! » (Actes des Apôtres 2,11)
C’est bien sur ces bases que peut s’édifier la communauté éducative, qui fait appel à « la participation différenciée à la mission éducative commune », selon le titre de la seconde partie du Statut. La liberté et la créativité de chacun sont sollicitées, pour la recherche du bien commun (art. 52).
La liberté
L’acte fondateur de la foi au Dieu d’Israël est la libération de l’esclavage, en Égypte.
« Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude. »
(Genèse 20,2)
Le Christ vient libérer l’homme du péché et de la mort, par la Rédemption et la Résurrection. La conception chrétienne de la personne humaine donne donc une place fondatrice à la liberté, et rejoint ainsi une aspiration majeure de nos contemporains.
Le Statut rappelle l’importance de l’éducation à la liberté, pour former à la capacité de poser des choix libres conformes à la conscience (art. 6), à l’esprit critique, au discernement éclairé (art. 24). L’éducation doit permettre à chacun de répondre librement à sa vocation (art. 37).
Encore faut-il s’entendre sur la liberté qui n’est ni licence, ni toute-puissance. Il peut être, dans notre environnement, et des formes nouvelles d’aliénation, et des conceptions erronées de la liberté, marquées par la seule recherche d’un bonheur égoïste et individualiste :
« L’ampleur et la rapidité des transformations réclament d’une manière pressante que personne, par inattention à l’évolution des choses ou par inertie, ne se contente d’une éthique individualiste. Lorsque chacun, contribuant au bien commun selon ses capacités propres et en tenant compte des besoins d’autrui, se préoccupe aussi, et effectivement, de l’essor des institutions publiques ou privées qui servent à améliorer les conditions de vie humaines, c’est alors et de plus en plus qu’il accomplit son devoir de justice et de charité. »
(Concile Vatican II, Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, n°30 § 1)
La responsabilité
La liberté de la personne humaine n’est féconde, pour la personne elle-même et pour la société, qu’articulée à la responsabilité. La liberté humaine s’inscrit pour chacun dans une vocation, un appel, qui invite à répondre : c’est ce qui constitue la personne comme responsable. Chacun est appelé à répondre de lui-même, de l’autre et du bien commun.
La responsabilité conduit ainsi à la collaboration, à la participation et à la solidarité (voir fiche Eléments de la pensée sociale de l’Eglise). L’éducation à la responsabilité constitue donc l’un des axes essentiels de tout projet éducatif :
« Mais pour que tous les citoyens soient poussés à participer à la vie des différents groupes qui constituent le corps social, il faut qu’ils trouvent en ceux-ci des valeurs qui les attirent et qui les disposent à se mettre au service de leurs semblables. On peut légitimement penser que l’avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d’espérer. » (Gaudium et Spes, n°31 § 3)
La personne humaine, être unifié et unique
La personne humaine désigne :
« [...] l’homme considéré dans son unité et sa totalité, l’homme, corps et âme, cœur et conscience, pensée et volonté [...]. » (Gaudium et Spes, n°3)
« L’homme corps et âme ». Le second récit de la Création révèle que l’homme est matière et souffle (Gn 2, 7), qui oriente, qui donne sens et dynamise. • L’homme « cœur et conscience ». Dans le vocabulaire biblique, le cœur est plus que le siège des sentiments et des émotions. Ce terme désigne l’intériorité de la personne, ses profondeurs. S’y rencontrent les affects, mais aussi la compréhension et l’intelligence du monde et des relations, aux autres et à Dieu. Et le cœur est donc le lieu de la conscience (Gaudium et Spes, n°11).
L’homme « pensée et volonté ». L’homme est doué d’une intelligence rationnelle qu’il est fondamental de former. Le juste exercice de la raison permet de mieux maîtriser son environnement, d’y trouver sa place et d’y agir, en usant du discernement qui permet la décision et la volonté, et l’usage éclairé de la liberté. Toute personne humaine recèle donc de multiples facultés complémentaires qu’il doit déployer pour advenir à son identité singulière. Chacun est ainsi doté de « talents » que l’Évangile appelle à faire fructifier (Mt 25,14-30).
Cet épanouissement personnel n’a cependant de sens que s’il prend simultanément en compte la dimension relationnelle de la personne humaine.
La personne humaine, être de relation
L’homme est créé à l’image de Dieu, de Dieu Trinitaire qui vit dans la relation des trois personnes de la Trinité.
« [...] Il [le Christ] nous suggère qu’il y a une certaine ressemblance entre l’union des personnes divines et celles des fils de Dieu dans la vérité et dans l’amour. »
(Gaudium et Spes, n°24 § 3)
Si Dieu fait de l’amour du prochain son premier commandement, c’est parce qu’il vit lui-même l’amour dans une Trinité de personnes. La personne humaine, selon la conception chrétienne, est ainsi appelée à vivre des relations dans une double dimension « verticale » et « horizontale ». Par le Christ, « premier né d’une multitude de frères » (Rm 8, 29), nous sommes invités à vivre une relation filiale au Père et cette condition de fils d’un même Père nous pousse à l’amour de nos frères :
« Et la preuve que vous êtes des fils, c’est que Dieu vous a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père ! Aussi n’es-tu plus esclave mais fils ; fils, et donc héritier de par Dieu. » (Épître aux Galates 4,6-7)
« Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. [...] N’aimons ni de mots ni de langue mais en actes et en vérité. » (Première Épître de saint Jean 3,14-18)
La dimension relationnelle de la personne humaine se vit donc dans la dynamique de la Croix, qui croise, précisément, la verticalité du Christ tendu vers le père et l’horizontalité des bras du Christ, ouverts à la multitude. Cette conception de la personne humaine, à accueillir et à développer dans toutes ses dimensions, fonde la proposition éducative de l’école catholique :
« La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre de l’enseignement de Jésus : c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est le but de l’école catholique. »
(Jean Paul II, Discours au 1er Congrès de l’École Catholique en Italie, Osservatore Romano, 24 novembre 1991)
La pensée sociale de l'Église propose une conception de la personne humaine et des relations en société qui offre à la fois un fondement et un horizon à l'École catholique. Elle relève de la théologie morale en ce qu'elle entend "orienter le comportement chrétien", tout comme l'École catholique s'efforce d'incarner une vision chrétienne du monde.
Dignité de l’homme, dignité du travail
Les principes de la pensée sociale de l’Église sont tous orientés vers le respect et la promotion de la dignité humaine. La dignité procède du fait que toute personne est créée à l’image de Dieu et qu’elle est appelée au salut. La dignité n’est pas liée à ce que l’homme fait, ni à sa situation sociale, ni à ce qu’il possède, ni à son état physique ou mental. Elle est liée à la nature humaine de la personne. L’homme est une personne unifiée. Il y a en lui une unité entre l’âme, le corps et l’esprit. L’homme est une personne unique et inimitable. Il est centre d’intelligence, de conscience et de liberté. Ainsi, il est capable de se connaître, de se posséder et d’entrer véritablement en relation avec les autres. La dignité de l’homme est son bien le plus précieux, c’est la raison pour laquelle elle doit être absolument préservée.

Le Statut invite, bien évidemment, à placer la dignité au cœur même de la mission éducative et du projet de l’école catholique.
art. 1 La dignité de la personne humaine fonde pour tous les hommes un droit à l’éducation.
art. 42 Par l’ensemble de ce qui la constitue, l’école catholique est au service de la dignité humaine et de la cohésion de la société. Elle contribue largement « à humaniser toujours plus la famille des hommes et son histoire » (Gaudium et Spes, n° 40 § 3).
La dignité professionnelle est respectée lorsque la personne est en mesure d’assumer pleinement sa charge, d’exploiter ses marges d’initiatives et d’avoir conscience qu’elle participe à la construction de l’œuvre commune.
Le bien commun
Le principe du bien commun est présent dans la pensée sociale de l’Église de manière constante. La définition qui fait référence est celle du concile Vatican II :
« [...] Le bien commun, c’est-à-dire cet ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée ». (Vatican II, Gaudium et Spes, n°26 § 1)
Ainsi, le bien commun n’est pas un état à atteindre ou à conserver, mais un moyen (« l’ensemble des conditions ») qui permettra aux personnes et aux communautés de s’épanouir et de se développer. Il n’est pas un bien que nous aurions en commun, mais il est ce qui est bon pour nous tous.
La recherche du bien commun s’inscrit dans une dynamique progressive, ce qui implique de manifester une volonté personnelle et collective d’amélioration des conditions de vie ensemble. • Elle se construit dans la relation, ce qui implique de développer une culture de l’échange et du dialogue.
Enfin, elle nécessite l’exercice d’une responsabilité, ce qui implique que chacun considère qu’il a un rôle à jouer dans cette recherche d’amélioration.
Le Statut sert le bien commun de l’Enseignement catholique. Les modalités d’organisation et de fonctionnement qu’il propose ont pour objectif d’améliorer les conditions d’exercice de la responsabilité de chacun en vue de la participation de tous à l’œuvre commune. C’est la raison pour laquelle il invite à ce que l’organisation, la gouvernance, le fonctionnement des instances nationales ou locales, ainsi que l’action des différents responsables soient « en vue du bien commun ».
art. 115 [...] Communauté éducative composée des élèves, des parents, de la communauté de travail et de tous les bénévoles, rassemblée autour d’un projet éducatif, [une école catholique] accomplit sa mission en vue du bien commun et rend un service éducatif d’intérêt général. [...]
La subsidiarité
Le principe de subsidiarité est un des piliers de la pensée sociale de l’Église. Voici la description qu’en propose Jean-Paul II :
« [...] Une société d’ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d’une société d’ordre inférieur, en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l’aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. » (Jean-Paul II, encyclique Centesimus Annus, n°48)
Dans la pensée sociale de l’Église, la subsidiarité est souvent évoquée au sujet des rapports entre les différentes strates de la société. Elle est également présentée comme un principe général d’organisation qui trouve des applications particulièrement pertinentes dans les organisations de travail.
Le respect du principe de subsidiarité implique plusieurs points de vigilance. Le premier consiste à veiller à ce que chacun, à la place qu’il occupe, ait une capacité d’initiative qui lui permette d’être acteur aux côtés des autres. Pour ce faire, il convient que les attributions de chaque personne et de chaque instance soient bien définies et connues de l’ensemble. Chacune doit disposer des moyens de remplir pleinement la mission qui lui est confiée.
Le deuxième point de vigilance consiste à favoriser un esprit d’entraide et de soutien mutuel, non pas pour faire à la place de l’autre, mais pour permettre à l’autre de mieux faire. Cet esprit d’entraide s’entend dans le cadre des relations verticales, hiérarchiques, du haut vers le bas, mais également du bas vers le haut. Il s’entend aussi dans le cadre des relations horizontales entre pairs.
Le troisième point de vigilance concerne la nécessité qu’il peut y avoir, exceptionnellement, de suppléer une personne ou une instance défaillante. Dans l’esprit de la subsidiarité, cette suppléance ne peut être que ponctuelle. De plus, elle doit s’accompagner de mesures permettant à la personne ou l’instance défaillante de mieux retrouver sa place. Le principe de subsidiarité suppose que chacun soit en mesure d’exercer pleinement sa responsabilité. C’est à dire qu’il soit en capacité de répondre de la mission et des tâches qui sont confiées. L’exercice d’une responsabilité crée un lien organique avec la communauté au sein de laquelle il est assumé.
Dans le Statut, le principe de subsidiarité est la colonne vertébrale des modalités d’organisation, d’une manière générale, et plus particulièrement pour les instances diocésaines et académiques. Les gestionnaires sont invités à tenir compte de ce principe et à le promouvoir.
art. 239 [...] Les formes d’organisation et de gouvernance interviennent à la seule mesure des besoins, comme un concours qui établit ou rétablit le niveau de proximité dans sa capacité d’initiative et dans ses moyens propres d’agir et de se développer.
La solidarité
« [La solidarité] n’est pas un sentiment de compassion vague ou d’attendrissement superficiel pour les maux subis par tant de personnes proches ou lointaines. Au contraire, c’est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c’est-à-dire pour le bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous [...] ». (Jean-Paul II, encyclique Sollicitudo Rei Socialis n°38)
La solidarité est un espace offert à tous pour participer au développement de chacun et à la croissance de la communauté. Elle est de nature à construire le lien qui unit les hommes entre eux et avec la société où ils sont implantés. Elle permet d’assurer la continuité du chemin des hommes, veillant à ce que personne ne reste sur le bas-côté.
La solidarité est un appel à sortir de soi-même, un moyen de quitter l’individualisme. Elle invite chacun à se comporter comme s’il était débiteur des autres et de la communauté. Elle conduit à concevoir des relations sociales justes, à fuir les comportements manipulateurs motivés par l’envie de pouvoir. La solidarité doit être vécue particulièrement dans l’attention aux plus fragiles et aux plus faibles. C’est ce que l’Église appelle : « l’option préférentielle pour les pauvres ». C’est-à-dire le choix qui est fait de mener prioritairement et résolument des actions envers ceux qui en ont le plus besoin.
Dans cet esprit, le Statut propose de vivre la solidarité entre les établissements, en faveur de ceux qui sont le moins favorisés. Il promeut des initiatives très concrètes, comme la mise en place de caisses de solidarité (art. 238). Par ailleurs, il qualifie de fonctionnement solidaire la cohésion et la parole commune dans les rapports avec les pouvoirs publics (art. 237).
La participation
L‘idée de l’implication et de la participation de chacun dans tous les domaines de la vie sociale est largement promue dans la pensée sociale de l’Église :
« [...] En prenant en considération les fonctions des uns et des autres [...] et en sauvegardant la nécessaire unité de direction, il faut promouvoir, selon des modalités à déterminer au mieux, la participation active de tous à la gestion des entreprises. » (Vatican II, Gaudium et Spes, n°68)
Cet extrait concerne la gestion des entreprises, mais la question de la participation doit être élargie à toute activité humaine y compris, bien entendu, au fonctionnement et à l’organisation de l’école catholique. Pour que la participation soit possible, certaines conditions doivent être réunies. Tout d’abord, chacun doit pouvoir disposer d’un niveau d’information le plus élevé possible. Ensuite, les processus de décision doivent être connus de tous. Enfin, les modalités d’échange et de dialogue doivent permettre régulièrement l’expression de chacun. Le Statut demande très clairement que la participation soit favorisée, en particulier s’agissant des relations de travail dans l’établissement.
art. 112 Comme communauté sociale, l’établissement doit favoriser la participation des personnes, quels que soient leurs statuts. Les relations de travail ne sont pas seulement régies par des liens hiérarchiques ; elles revêtent aussi un caractère de partenariat. [...]
art. 241 À tous niveaux, l’organisation de l’Enseignement catholique repose sur la participation des acteurs. Les formes associatives et collaboratives sont donc favorisées dans la structuration institutionnelle.
La participation, telle qu’elle est envisagée dans la pensée sociale de l’Église, ne s’oppose pas à l’existence d’une autorité légitime et d’une organisation hiérarchique. Au contraire, l’Église a toujours défendu la nécessité d’une autorité unique qui conduit la communauté et d’une structuration de l’activité qui est indispensable au développement de tout projet.