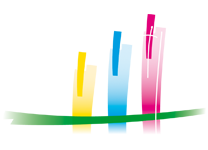Publié le : 23 septembre 2025
L’Enseignement catholique entend faire bouger les lignes
Lors de sa première conférence de presse de rentrée, le 23 septembre dernier, Guillaume Prévost, nouveau secrétaire général de l’Enseignement catholique a regretté que trop de polémiques occultent les défis éducatifs immenses que la société devrait, selon lui, s’employer à relever collectivement.
Sortir de l’empilement de polémiques stériles, des guéguerres entre discipline positive et sanction réparatrice, des argumentaires sans fin sur le sexe des anges… « Mettre en exergue ces conflits c’est une manière de fuir nos responsabilités », a asséné Guillaume Prévost aux journalistes venus en nombre assister à sa conférence de presse de rentrée, le 23 septembre dernier, au foyer des élèves du groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul, à Paris. Tout en rendant hommage à ceux qui s’engagent dans une « relation éducative singulièrement tourmentée », pour lesquels il a souhaité une « revalorisation salariale », le secrétaire général de l’Enseignement catholique a invité l’ensemble de la société à réfléchir « aux terrains d’entente » qui permettraient de renouveler cette dernière. Ne manquant pas d’insister sur le fait que les 7500 établissements de l’Enseignement catholique, premier acteur de l’économie sociale et solidaire en France, avaient un rôle à jouer et une expertise à partager. À commencer par l’affirmation « ouverte et apaisée d’un projet pleinement ouvert à tous, pleinement universel et donc pleinement chrétien ».
« L’Enseignement catholique est un collectif qui va bien et même très bien et dont la singularité repose sur la confiance. » Et en premier lieu la confiance des familles qui choisissent surtout ses établissements au collège, âge délicat des premières prises d’autonomie, les effectifs de l’Enseignement catholique augmentant de 50% en 6e. « Ce n’est pas une fuite du public mais bel et bien un choix. Celui de la proximité, de structures à taille humaine qui valorisent la relation ainsi que l’alliance avec les familles », a argumenté Guillaume Prévost.
voir l'encadré ci-contre →
→ voir l'encadré ici
Les abus nous engagent à revivifier la relation éducative
En ouverture de son allocution, Guillaume Prévost a tenu à rappeler la gravité des abus révélés l’an dernier : « Ce qui s’est passé à Bétharram – ces abus, ce dévoiement de l’autorité – est sérieux, très sérieux. Les jeunes blessés et leurs parents ont été trahis à l’endroit même de la promesse que nous leur faisions. Cette trahison nous engage à une responsabilité accrue. »
En écho aux propos d’Alain Esquerre, ancien porte-parole d'un collectif de victimes de Bétharram, ou de son prédécesseur Philippe Delorme, le secrétaire général a souligné la responsabilité historique de l’Enseignement catholique et la nécessité d’une introspection profonde de l’institution, afin que de tels abus et violences ne puissent plus se reproduire. « Il ne s’agit pas d’un catalogue de mesures, mais de poser un regard global sur ces drames, et d’y répondre par le dialogue », a-t-il poursuivi.
Guillaume Prévost a rappelé les actions engagées ces dernières années :
- Création de cellules d’écoute et d’accompagnement des victimes dans tous les diocèses.
- Protocoles de signalement en lien avec les pouvoirs publics (80% des directions diocésaines ont signé un accord ou protocole de signalement avec les pouvoirs publics : procureurs, Crip).
- Appels à témoins.
- Constitution d’un réseau de référents dédiés au sein de chaque direction diocésaine (120 référents à ce jour).
- Cellules de veille spécifiques dans plusieurs directions diocésaines (Nantes, Avranches, Saint-Lô).
Des démarches de justice restaurative complètent ces dispositifs, afin de soutenir localement les jeunes victimes et leurs familles. Le secrétaire général a par ailleurs salué le courage de plusieurs diocèses, notamment celui de Nantes, qui ont choisi de révéler publiquement des histoires douloureuses.
Entre 1950 et 2020, 330 000 personnes ont subi des abus sexuels dans l’Église en France, dont 100 000 dans l’Enseignement catholique, particulièrement touché en raison du poids des internats et d’une culture de l’autorité. Pour y mettre fin, cinq établissements pilotes vont expérimenter, d’ici à décembre, un audit préparé avec un cabinet externe.
Pour, Guillaume Prévost, cela préfigure un processus de long terme – deux, cinq ans et plus – qui entraînera l’ensemble des communautés éducatives dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité. Ce travail s’appuie sur l’« audit de progrès » et sur le plan Boussole, appelé à devenir le référentiel unique d’évaluation des établissements. La direction diocésaine de Besançon a ainsi choisi de relire tous les projets d’établissement à travers ce référentiel.
Ces drames s’inscrivent dans un contexte sociétal plus large. Le rapport Santiago sur la protection de l’enfance a révélé une forte fragilité du rapport aux enfants : en vingt ans, le nombre de mesures de l’Aide sociale à l’enfance a augmenté de 50 %. Suicides d’élèves ou d’enseignants, agressions entre pairs, abus : autant de signaux d’une perte de légitimité de l’autorité éducative. Guillaume Prévost a toutefois mis en garde : « Il ne faut pas que la remise en cause de l’autorité éducative conduise à son effacement. Nous ne pouvons pas laisser les enfants seuls, en prise directe avec une société de consommation qui les prend pour cible. »
Complémentarité de l’offre et mixités
L’impact de la baisse de la démographique sur le constat de rentrée, sensible mais modéré, atteste de cette confiance des familles. Par ailleurs, dans les secteurs où l’offre de l’Enseignement catholique n’est pas suffisante pour répondre à la demande, comme dans l’Est, le Sud-Est, dans les académies de Versailles ou de Créteil, la proportion d’élèves scolarisée dans l’Enseignement catholique augmente, dans un contexte général de diminution.
Pour Guillaume Prévost, ce sont les effets délétères d’un développement empêché qui nuit à l’accueil de tous : « Depuis 2018, l’Enseignement catholique a redistribué 2000 postes en interne pour les établissements qui engagent des efforts envers les plus fragiles et ce malgré une perte de 2500 postes d’enseignants sur la même période », a-t-il fait valoir, en évoquant l’ouverture du collège Loyola à Marseille, celle d’un lycée, dans la région enclavée de l’Est de la Réunion ou encore un dispositif d’insertion professionnelle innovant pour les jeunes en situation de handicap, expérimenté notamment à Saint-Martin de Roubaix.
Pourtant, cette volonté d’ouverture à un public défavorisé reste tributaire de la confiance de la puissance publique : à Floirac, en périphérie de Bordeaux, où un projet de création d’établissement a été refusé par le Rectorat, ou encore dans le Jura où la nouvelle carte des transports scolaires exclut les élèves de l’Enseignement catholique. « Or, nos établissements restent fragiles, 70% affichant une capacité d’autofinancement inférieure à 20 et, pour un quart d’entre eux inférieure à 5, ce qui compromet leur pérennité », a souligné Guillaume Prévost. Un constat corroboré par Pierre-Vincent Guéret, président de la Fédération nationale des Ogec qui a rappelé que les forfaits variaient d'un rapport de 1 à 30 en fonction des communes. Il a estimé que la compensation du déficit de financement de l’État représentait en moyenne 400 euros par famille.
« Un élève de l’Enseignement catholique coûte 50% moins cher au contribuable qu’un élève du public… Mais moins la puissance publique finance l’Enseignement catholique, plus celui-ci est de facto réservé aux riches », a conclu le secrétaire général.
Dialoguer, notamment sur la laïcité
Sur les 550 contrôles d'ores et déjà effectués, aucun ne remonte de dysfonctionnement notable. « Tout au plus, quelques incompréhensions sur les normes qui nous sont applicables (organisation du temps scolaire et composition des classes, par exemple) qui montrent combien ces contrôles ouvrent une surface de dialogue dont on doit se saisir. » Notamment sur l’articulation du projet éducatif chrétien et du respect de la liberté de conscience.
« Allez-vous dans un resto chinois pour commander des pizzas ? Considérez-vous qu’emmener vos enfants à une messe de mariage d’amis contrevient à leur liberté ? »
Un brin provocateur Guillaume Prévost persiste et signe : « Nos enseignants, agents publics de l’État mais pas fonctionnaires, ne sont pas soumis au principe de neutralité. Ils peuvent témoigner de leur foi sans prosélytisme, ils peuvent proposer des temps d’intériorité en précisant s’ils s’adressent à tous ou aux seuls chrétiens de manière facultative et ils peuvent même faire des maths chrétiennes en convoquant la métaphysique d’Aristote ! »
Attractivité maintenue en 6e et en 2de
La perte d’effectifs que connaît l’Enseignement catholique en cette rentrée (-0,6%) correspond à la baisse démographique et aux prévisions de la Depp. Comme prévu, elle est importante dans les secteurs où l’Enseignement catholique est bien représenté (académies de Lille, Nantes et Rennes).
Mais si l’Enseignement catholique perd moins d’élèves que prévu en primaire (avec une augmentation encourageante en maternelle à signaler), ses effectifs du second degré diminuent alors qu’ils étaient attendus à la hausse. À noter toutefois que les niveaux d'entrée au collège et au lycée, les classes de 6e et de 2de maintiennent leur attractivité, les pertes d'élèves se concentrant sur la fin de collège.
Après des années d’érosion de leurs effectifs, les lycée pro gagnent 2000 élèves et les BTS plus de 600.




Evars : pas de programme bis !
Face à un feu de questions nourri sur l'Evars, le nouveau programme d’éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle, Nathalie Tretiakow, adjointe au secrétaire général, a apporté deux précisions importantes : « Oui, l’Evars est mise en œuvre, un webinaire donné en juin pour accompagner son déploiement ayant été suivi par plus de 2000 de nos chefs d’établissement. Et non, le texte "Grandir heureux", sur les fondamentaux de la relation dans l’Enseignement catholique n’a rien à voir avec un programme bis ! »
Et Jean-François Canteneur, directeur diocésain de Paris, a également clarifié la question des intervenants non agréés : « Nous travaillons l’EARS sous cette appellation maison depuis une quinzaine d’années et, par exemple à Paris, plus de la moitié des collèges s’acquittaient des trois séances annuelles obligatoires, loin devant les 15% d’établissements du public… Souvent nos structures faisaient pour cela appel à des associations, faute d’enseignants à l’aise et volontaires pour aborder ces sujets. Et cette forme d’extériorité sur ces sujets pouvait être intéressante pour les jeunes. Aujourd’hui, avec l’Evars, les enseignants se réapproprient cette dimension éducative et c’est tant mieux car ces questions se travaillent aussi dans le quotidien des établissements. »
C’est un processus en cours et des associations continuent à intervenir hors temps scolaire pour apporter des compléments au programme. Certaines travaillent en lien avec les parents d’élèves qui ont aussi besoin d’accompagnement sur ces questions qui, par excellence, relèvent de la co-éducation.