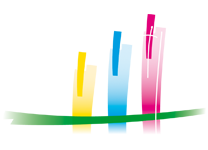Publié le : 28 juin 2017
« Ne pas construire le nous contre le je »
 Comment vivre ensemble quand le « faire société » a perdu de son évidence ? C’est une des questions que travaille le sociologue Bertrand Bergier, professeur à l’Université catholique de l’Ouest1. Le chercheur invite les éducateurs à une posture nouvelle qui articule à la fois le « je » et le « nous », le conflit et l’autorité, pour permettre aux jeunes d’accéder au sens.
Comment vivre ensemble quand le « faire société » a perdu de son évidence ? C’est une des questions que travaille le sociologue Bertrand Bergier, professeur à l’Université catholique de l’Ouest1. Le chercheur invite les éducateurs à une posture nouvelle qui articule à la fois le « je » et le « nous », le conflit et l’autorité, pour permettre aux jeunes d’accéder au sens.
Propos recueillis par Aurélie Sobocinski
Où en sommes-nous du commun dans notre société ?
Bertrand Bergier : Il me semble que la construction du commun, du « faire société » est confrontée aujourd’hui à une crise de la symbolisation qui est d’abord une crise du repliement. L’étymologie grecque du mot « symbole » renvoie, selon le contexte, à l’idée de jeter ensemble, mettre en commun, échanger, se rencontrer. Or la période est plutôt marquée par le délitement social, par des individus atomisés qui ne se sentent plus forcément liés par un intérêt commun. Chacun se croit réduit à ne s’occuper que de lui-même. Le défi aujourd’hui est le suivant : comment, dans une société du « tout à l’ego », construire de l’appartenance ?
Ce vivre ensemble a longtemps fait consensus… Qu’est-ce qui le fragilise aujourd’hui ?
B. B. : Jusqu’au XIXe siècle et une large moitié du XXe siècle, l’appartenance à une famille, à une profession, à une génération, à un milieu social dictait un ordre, des rapports statutaires, une hiérarchie. La question de la coexistence et surtout du sens de cette coexistence ne se posait pas, c’était plutôt une réponse solidement ancrée. Chacun connaissait les règles du jeu le concernant. Se soumettre ou les transgresser était une autre affaire. En tous cas, les contours de ce dénominateur commun étaient nets. Ils ne le sont plus. Ce qui est nouveau, c’est la question du « comment » ? Le vivre ensemble a perdu de son évidence. Sa présence muette faisait précisément que la question ne se posait pas. Le « comment » témoigne de l’ouverture d’un vaste chantier, du « commencement d’un monde », comme le dit si justement l’essayiste Jean-Claude Guillebaud.
De quelle façon cette thématique s’est-elle imposée dans vos recherches ?
B. B. : En tant que chercheur, j’ai décidé de porter un regard sur ce qui fonctionne contre toute attente plutôt que de chercher à comprendre exclusivement ce qui dysfonctionne. C’est ainsi que je me suis intéressé, par exemple, à l’itinéraire de ces multi-redoublants dont le destin scolaire semblait scellé par avance et qui aujourd’hui sont en cinquième année de médecine ou en dernière année de doctorat. Ou encore à ces personnes sans portable ni télé et à la façon dont ces réfractaires qui s’offrent un exil technologique, viennent nous interroger sur les limites d’une connexion illimitée, sur le rapport à soi, aux autres, au monde… Avec l’interrogation suivante : en quoi ce qui paraît atypique, voire utopique aujourd’hui, porte en germe le typique de demain ?
Avez-vous repéré une autre façon de penser et de fabriquer un commun ?
B. B. : L’un des premiers défis à mes yeux consiste à ne pas construire le « nous » contre le « je », mais plutôt à penser leur articulation. Comment à l’École, dans le quartier, encourager à la fois l’initiative individuelle et la coopération ? Penser le « être seul » et le « être avec » ? La réponse n’est pas du côté d’une pensée comptable. Dans une société où prévaut « ce qui se compte » sur « ce qui compte », il s’agit au contraire pour les éducateurs, dans cette fabrique du commun, de redonner de la place à l’utopie, au rêve. Une École qui ne sait plus cultiver et transmettre une vertu d’espérance est une École qui non seulement désespère d’elle-même mais désespère aussi de la génération qu’elle accueille. Quelle espérance pouvons-nous collectivement définir et incarner ?
Comment cela pourrait-il se concrétiser sur le plan pédagogique ?
B. B. : L’enjeu est de pouvoir penser à la fois l’éducation à la coopération et l’éducation à la confrontation. S’agissant de la première, il s’agit de montrer à travers des activités qu’il y a des interdépendances positives pour le « nous » et pour le « je » au sein du nous. Il s’agit aussi de marquer des pauses, chemin faisant, pour inviter chacun individuellement et collectivement à pouvoir évaluer ce qui se passe dans la construction du commun.
Concernant l’éducation à la confrontation, c’est plus délicat : elle exige d’abord des adultes capables de s’accorder sur les coordonnées de la confrontation (se mettre d’accord à la fois sur l’objet du désaccord et sur un temps et un lieu pour en parler). Il s’agit ensuite, en amont du débat, de se donner un temps d’intériorité pour verbaliser les pensées, les émotions et les sensations. Ce triple apaisement est une des conditions pour oser exposer ses « bonnes raisons », tout en prenant le risque d’écouter celles d’autrui. Une telle éducation n’est pas aisée dans notre culture où prévaut l’idée que le conflit est destructeur.
Le commun appelle une culture de l’espérance, de la résistance, mais aussi de la régulation, selon vous…
B. B. : La fabrique du commun tient dans la mise en tension de ces trois « apprentissages », chacun pouvant avoir ses excès. Celui de la régulation a un mérite : il est très pragmatique, tourné vers le mode opératoire, le « comment faire ? ». Son écueil : verser dans des procédures tatillonnes, des rationalités étriquées.
L’apprentissage social de l’utopie fixe le cap. La question fédératrice peut se formuler ainsi : à quoi disons-nous collectivement « oui » ? Il s’agit de définir nos espérances concernant celles et ceux qui frappent à la porte de nos écoles, tout en veillant à ce que cette aspiration puisse se concrétiser.
L’apprentissage social de la résistance, quant à lui, dénonce le fatalisme et constitue une puissance de détection de ce qui menace le « faire société » (comme la clôture identitaire ou le non-accueil des plus vulnérables…). Il a, lui aussi, son champ aveugle : il a besoin de mots d’ordre qui peuvent simplifier abusivement une réalité par définition complexe. Il peut s’installer dans le « non » systématique.
Vous évoquez un dernier pôle pour atteindre la quadrature du sens, celui de l’autorité…
B. B. : Effectivement, il n’y a pas de fabrique du « commun » sans rapport à la loi, à l’autorité. Celle-ci renvoie à des règles mais surtout à ce qui les fonde. L’autorité prend à contre-pied l’autoritarisme d’un éducateur tout puissant, dominé par la peur de ne plus être rien s’il n’est pas tout.
L’autorité, au contraire, pense ses propres limites, est ouverte au conflit des argumentations. Elle refuse à la fois l’écueil de la toute-puissance et celui du renoncement. Figure d’autorité assumant son ascendant, l’éducateur fixe un horizon. Mais il lui faut compter encore et toujours avec la liberté du « je » et du « nous » qui peut dire oui ou non. L’éducation trouve précisément sa raison d’être dans cette possibilité. Il s’agit alors pour l’autorité d’assumer les inévitables « ratés » et désillusions tout en continuant à exiger le meilleur et à se préparer à accepter le pire, sans cesser de croire en la capacité de l’individu et du collectif d’apprendre et de croître.
Pour initier ce commun, à quel premier changement sont invités les éducateurs ?
B. B. : Sans doute, convient-il de redonner de la place à la question. Nous sommes trop souvent du côté de la réponse, du « savoir constitué ». Cela nous rassure. Mais il n’y a pas d’éducation sans risque. Délaisser nos réponses pour inviter le jeune à se coltiner le « pour quoi » de la finalité, à y réfléchir et à produire sa propre réponse. Intégrer l’autre « pourquoi », celui de la causalité, qui invite à regarder dans le rétroviseur le chemin parcouru. Il s’agit de (re)faire place à un art du questionnement. Évidemment, cela prend du temps, mais ce n’est pas du temps perdu : ce qui se joue là, c’est le temps de l’éclosion du sens. On ne fabrique pas du commun avec des orphelins du sens.
1 Auteur de Comment vivre ensemble ? La quadrature du sens, Chronique sociale, 2014.